OBSERVATOIRE
MFP

La souffrance éthique,
l’esprit sous tension
Souffrance éthique. Ces deux mots résument un vaste pan des fragilités vécues par les agents de la Fonction publique. On entre souvent dans ces métiers par vocation. Pour être utile. Année après année, cette utilité semble se disloquer et le sens du travail s’effrite à son tour. Marie Pezétraite de la souffrance au travail depuis 1997. Tant dans le privé que dans le public. Sa lecture comparée est très instructive car elle est sans fard, sans langue de bois.

Depuis plus de 20 ans, Marie Pezé s’intéresse aux fragilités que l’activité professionnelle peut engendrer. Elle a été, en effet, l’initiatrice de la première consultation Souffrance au travail au Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre en 1997. Aujourd’hui, elle livre un regard nourri d’expériences, de témoignages et de sensibilité.
Selon une étude récente, 75 % des agents publics souffrent de stress et 84 % se sentent souvent fatigués. Pourquoi éprouvent-ils autant de stress et de fatigue ?
Marie pezé Je pense qu’on ne peut pas faire de différences entre les travailleurs du privé et ceux du public. Actuellement les nouvelles formes d’organisation du travail produisent une telle intensification du travail, un travail qui s’effectue avec tellement d’effectifs insuffisants, de temps insuffisant et de moyens insuffisants que tout le monde travaille en mode dégradé. Nous constatons donc dans le privé, comme dans le public, les mêmes effets, les mêmes organisations, c’est-à-dire l’épuisement professionnel, les crises de nerfs, les tentatives de suicide, les pathologies cardiaques, les pathologies métaboliques. s’ajoutent parfois l’archaïsme et la technocratie très forte de la Fonction publique. Deux couches supplémentaires au mille-feuille. Sans oublier le devoir de réserve du fonctionnaire qui est plus englué dans le silence que dans le privé et l’impossibilité de changer de poste.
Pour faire écho à votre remarque, il apparaît que près de la moitié des agents de catégorie A, en milieu hospitalier notamment, déplorent de grands états de fatigue. Quelle est la spécificité de cette catégorie ?
M.P. J’étais moi-même catégorie A à l’hôpital. Dans cette logique de transformer les institutions et les administrations en “entreprises comme les autres”, l’hôpital a été intégré et a connu des effets pervers un peu plus spécifiques : comment transformer le fait de prodiguer des soins en “on va les produire” avec la tarification à l’acte ? On voit bien comment l’hôpital qui était une machine faite pour un fonctionnement humaniste, est devenu un aéroport, une usine comme les autres.
Et un quotidien qui se transforme ?
M.P. Au bout de la chaîne, les équipes aux urgences reçoivent ce flot ininterrompu de patients qui ne trouvent pas suffisamment de médecins en ville. Aux consultations, c’est pareil. Des files d’attente, des infirmières, souvent seules. Et puis dans les services administratifs, il y a celles et ceux qui font face à une grammaire chiffrée, cette importation à l’hôpital de tous les outils de la financiarisation de l’économie : les tableaux de bord, les reportings… Le chiffrage d’une activité de travail qui est inestimable uniquement par des chiffres. Ce qu’un soignant ou un administratif engagé dans son travail peuvent mettre dans leur tâche d’honneur, de conscience professionnelle, de sueur, d’inventivité, de ruse, tout cela est inestimable et impossible à quantifier dans des tableaux chiffrés qui ont été mis en place essentiellement pour contrôler le travail et augmenter la productivité. À l’hôpital, c’est un choc avec, d’un côté, un travail réorganisé par la financiarisation et, de l’autre, la logique historique d’accueil de la souffrance à l’hôpital. Les deux sont tellement incompatibles qu’au milieu il n’y a que les soignants, un personnel écartelé qui met tout en oeuvre pour que “ça tourne quand même”. Là on est au bout du bout.
Au bout du bout ?
M.P. La financiarisation est une chose mais les outils de la financiarisation gauchissent le rapport au travail. Au-delà de créer de l’argent par les soins que l’on produit, la manière d’organiser les soins ne peut pas être basée que sur du contrôle par les chiffres ou par une optimisation des effectifs ou bien par une super polyvalence qui aboutit à la négation des compétences. Il y a aussi des règles de base, des règles de métier comme bien soigner le patient. Sur le terrain, celui qui travaille est seul face à des impasses du réel.
N’est-ce pas le contexte particulier de l’hôpital ?
M.P. Je ne citerai pas l’institution où je suis allée récemment et où les syndicats me racontaient que les secrétaires sont dans les couloirs avec les parapheurs pour chacun des directeurs de services. Parfois, il n’y a qu’une lettre dans le parapheur et elles se trimbalent donc avec 7 ou 8 parapheurs dans les bras. Soit plusieurs kilos tout ça pour promener un courrier. Mais sur quelle planète vit-on ? Même l’ergonomie la plus élémentaire, le bon sens, disparaît au profit d’archaïsme, d’usages qui sont là et auxquels on ne touche pas. Dans cette culture de l’obéissance maximale, dans ce silence absolu sur ce qui se passe, dans cet univers de baronnies archaïques, les nouveaux outils qui devraient nous faciliter la vie deviennent des outils au service du ralentissement, des accentuations de la complexité supplémentaire des tâches.
“Actuellement les nouvelles formes d’organisation du travail produisent une telle intensification du travail, un travail qui s’effectue avec tellement d’effectifs insuffisants, de temps insuffisant et de moyens insuffisants que tout le monde travaille en mode dégradé.”
Avec cet esprit sous tension, comment peuvent réagir les fonctionnaires ?
M.P. Comment voulez-vous qu’ils s’en sortent ? Des policiers aux soignants en passant par les enseignants… À tous les étages de la Fonction publique, nous recevons aussi des directeurs d’hôpitaux, des chefs de service de très haut niveau des ministères… tous deviennent fous. Le système est à bout de souffle. Je pense que Kafka de nos jours irait se suicider tellement nous sommes aux prises avec une folie. Notre pays manque de pragmatisme. Tout cela participe à faire des fonctionnaires la cible des critiques. Quand on dit “les fonctionnaires”, c’est une espèce de grand concept poubelle et quand vous titillez un peu les gens, ils amenuisent leurs critiques : “Ah non pas les infirmières. Pas les soignants, non plus. Ah non pas les policiers. Et pas les enseignants, non plus. Ah non pas les pompiers, ni ceux-ci, pas ceux-là.” Alors il reste qui ? Il reste qui maintenant que vous avez enlevé les gens dont vous avez besoin pour que ça tourne ?
Jusqu’à quel point, cette mise sous tension vient-elle dégrader le travail et le mental des fonctionnaires ?
M.P. Le terreau de l’épuisement des soignants, quelle que soit leur fonction à l’hôpital, c’est le travail en mode dégradé. C’est un geste de métier, un geste de soins dans lequel je ne peux plus me reconnaître, un geste que je n’effectue plus dans les règles de métier. Ce qui épuise les soignants c’est de faire et de vivre ce travail dégradé qui ne ressemble plus à du soin. C’est la file des patients allongés sur des brancards aux urgences, c’est être bazardé dans un service où on ne connaît plus la qualité des soins, c’est l’agressivité que l’on est obligé d’avoir quand on répond à un patient qui s’énerve. Il est là le terreau de l’épuisement. C’est le travail abîmé, malmené, le travail en mode dégradé.
Une souffrance contagieuse…
M.P. Cette souffrance a un nom. Souffrance éthique, c’est ainsi que nous l’appelons. Cette souffrance éthique est au premier plan de ce burn-out dans lequel on met tout et que l’on transforme, lui aussi, en concept poubelle. La souffrance éthique est à l’origine de tout. Vous la retrouvez avec l’assistante sociale qui n’a même pas un bureau pour recevoir des gens qui vivent dans une misère grandissante. Vous la retrouvez encore avec l’assistante sociale qui est obligée de demander à un père la dernière quittance de loyer pour démarrer la prise en compte d’une allocation éventuelle. Elle lui demande la dernière quittance de loyer que le père n’a pas pu payer et c’est d’ailleurs pour ça qu’il vient demander de l’aide. Cette assistante sociale est confrontée à la folie d’un système administratif extrêmement contraignant, un système qui n’a pas revu sa copie par rapport à la souffrance des populations. Un système qui place l’assistante sociale dans une forme d’injonction paradoxale : comment vais-je obtenir la quittance de loyer qui me permet de démarrer la demande de l’allocation d’un homme qui a besoin d’allocations pour payer son loyer ?
Avec une question centrale : comment être utile ?
M.P. Exactement. Comment voulez-vous que les fonctionnaires soient contents lorsqu’on leur impose un système qui ne rend pas service ? Les fonctionnaires c’est le service public d’abord. Leur métier, leur raison d’être, c’est rendre service.

“Cette souffrance a un nom. Souffrance éthique, c’est ainsi que nous l’appelons. Cette souffrance éthique est au premier plan de ce burn-out dans lequel on met tout et que l’on transforme, lui aussi, en concept poubelle.”
À vous entendre, cette mise sous tension est donc permanente.
M.P. On a tellement intensifié le travail partout, et ça l’enquête SUMER(1) le montre bien, que tout le monde est effectivement soumis à ce qu’on appelle le Job Strain(2) . C’est-à-dire à un travail à flux tendus, sans interruption, avec une production de cortisol incessante qui va du coup produire, chez les fonctionnaires comme ailleurs des myalgies, des troubles musculo-squelettiques, des problèmes cardiaques, des diabètes insulino-dépendants, des cerveaux abîmés sur un plan cognitif que l’on peut mesurer avec des bilans neuropsychologiques…
(1) Surveillance médicale des expositions des salariés aux risques professionnels
(2) Stress au travail
Tout s’esquinte : l’esprit comme le corps.
M.P. Et ça se généralise. On voit que, même sur les métiers qui ne sont pas des métiers d’urgence comme le SAMU, les pompiers ou les flics de la BAC, la situation sociale s’est aussi dégradée. Aux guichets, les gens qui, autrefois faisaient du travail véritablement administratif, font maintenant du travail de pompier social. Les gens à l’accueil de la CAF vous racontent leur désarroi : “Lorsque je dois refuser une allocation, les gens se mettent à pleurer parce qu’ils n’ont pas de quoi finir le mois. Ils n’ont pas de quoi manger et donc je leur donne un ticket de métro pour qu’ils ne repartent pas à pied. Il m’est arrivé de donner 10 euros parce que la maman n’avait rien pour faire à manger le soir.” Ces gens-là nous disent : “Je ne peux pas faire autrement.” Ce qui est effrayant c’est lorsque l’on remonte ces situations à leurs supérieurs hiérarchiques et que l’on s’entend répondre : “Ce n’est pas professionnel, ce sont des administratifs, ils (ou elles) n’ont pas à intervenir.” Mais ce sont des assistantes sociales, donc elles font leur métier car leur métier c’est d’aider, c’est pour cela qu’elles le choisissent ce métier-là.
Est-ce vraiment une réalité partagée ?
M.P. Le rapport Gollac(3) qui traite des différents indicateurs de risques psychosociaux évoque bien les exigences émotionnelles du poste de travail. Ces femmes de la CAF nous le disent avec beaucoup de justesse : “Ce n’est pas parce que j’ai pitié, c’est parce que je suis une citoyenne. Ce que mon institution ne fait plus, je me dois de le faire.” Ce n’est pas un manque de rigueur professionnelle, c’est une marque de solidarité face à des institutions devenues défaillantes. D’ailleurs la souffrance des fonctionnaires actuellement c’est la défaillance de leurs institutions, ils le disent tous. Autrefois l’institution avait un poids social, une place symbolique, une puissance sociologique qui faisaient que malgré ces travers, son archaïsme, sa lourdeur, son inertie, elle avait un impact sur le social. Maintenant toutes ces administrations courent derrière les injonctions financières et il leur manque la souplesse du privé. Les gens voient qu’il y a une disparition de l’épaisseur symbolique des institutions et ils en souffrent.
(3) Le rapport Gollac présente une série de recommandations pour évaluer 6 grands facteurs de risques psychosociaux au sein d’une entreprise
L’employeur public les protège-t-il encore ?
M.P. Les agents de la Fonction publique sont mal protégés par leur système de santé, mal protégés par le droit public et de surcroît quand ils arrivent à la retraite ils sont souvent en mauvais état. Ils ont échangé la sécurité de l’emploi contre de moindres revenus. Or vous voyez bien que la sécurité de l’emploi est remise en cause sans arrêt. La soutenabilité jusqu’à la retraite de son métier n’est pas toujours tenable. Beaucoup finissent en longue maladie avec des revenus extrêmement entamés ou bien sont mis en retraite anticipée et ils se retrouvent alors dans une vraie précarité. La médiocrité du niveau de salaire, la médiocrité du niveau de la retraite… non il faut arrêter de penser que le fonctionnaire est un nanti.
“Comment voulez-vous que les fonctionnaires soient contents lorsqu’on leur impose un système qui ne rend pas service ? Les fonctionnaires c’est le service public d’abord. Leur métier, leur raison d’être, c’est rendre service.”
Avec les carences que vous relevez, est-il encore possible pour les fonctionnaires de se sentir encore indispensables ?
M.P. Oui, je vois des gens profondément engagés encore dans ce qu’ils considèrent comme étant le service public. Ils sont profondément soucieux. J’ai en ce moment en suivi quelqu’un qui répond au téléphone dans un hôpital, au standard. Le travail invisible que font ces hommes et ces femmes, c’est juste extraordinaire. Ils sentent l’urgence à la voix, ils finissent par connaître les voix qui appellent souvent, ils leur demandent des nouvelles. Ces gens-là font tout pour que ça reste du joli service public à tous les niveaux et c’est d’ailleurs pour cela que ça tient encore. L’hôpital ce n’est que des murs ça ne tient que par les gens qui sont dedans. C’est vraiment parce qu’il y a des médecins, des infirmières, des aides-soignants et toute une population d’administratifs qui se donnent beaucoup de mal que l’hôpital tient. Il y a encore des gens extraordinaires partout. Le jour où ils vont lâcher, les hôpitaux ne vont pas voir leurs murs s’effondrer, ils vont pas voir leurs murs s’effondrer, ils vont voir s’effondrer leur fonctionnement… et ça, on le sait.
Pouvez-vous nous aider à esquisser des mesures pour mieux protéger les agents de la Fonction publique ?
M.P. Les mesures, elles existent. Partout les chefs d’établissement doivent aux fonctionnaires la protection de leur santé physique et mentale. Si les fonctionnaires connaissaient un peu mieux les lois… Tenez, je suis sûre que beaucoup de fonctionnaires ne savent pas que l’ordonnance de janvier 2017 dans son article 10 inverse la preuve pour un accident du travail. Auparavant, le fonctionnaire devait apporter la preuve qu’il s’agissait d’un accident de service. Sinon, la direction ne l’acceptait pas. C’est terminé, on vient d’aligner le public sur le privé. Maintenant c’est à l’administration d’apporter la preuve
que ce n’est pas un accident du travail. Je suis sûre que la plupart des fonctionnaires ne savent pas que cette ordonnance a été publiée. Une dernière chose : il faut protéger sa santé, il ne faut pas attendre que les directions la protègent, elles ne le feront pas. Une fois qu’on l’a perdue, surtout dans la Fonction publique, on est mal en point et mal protégé. Il faut tout faire pour ne pas la perdre. Il faut régulièrement se tester et aller consulter quand c’est nécessaire. C’est essentiel.
QUI EST
MARIE PEZÉ ?
Psychologue et psychanalyste, elle est l’initiatrice de la première consultation “Souffrance au travail” au Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre en 1997. De 2002 à 2014, Marie Pezé est experte près de la cour d’appel de Versailles en psychopathologie du travail. Elle s’intéresse particulièrement aux symptômes liés aux traumatismes professionnels, les symptômes liés au harcèlement moral, les troubles musculo-squelettiques et l’anatomie administrative.
QUELLES LECTURES…
POUR ALLER PLUS LOIN ?
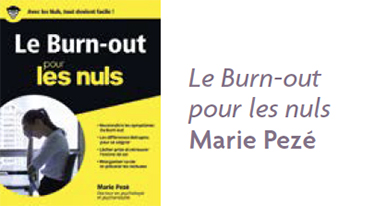

DÉCOUVREZ NOS AUTRES INTERVIEWS






